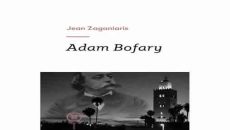Point de vue
Par Jean Zaganiaris, professeur de philosophie
« Pourvu qu’il soit de bonne humeur » (Editions La Croisée des Chemins, 2020, 3ème édition 2022) de Loubna Serraj est un roman d’une sensibilité rare. Il met face à face les victimes et les bourreaux, la paix et la guerre, la violence et la douceur du monde, et invite à regarder d’un œil nouveau la domination masculine et les violences conjugales. Il nous livre également une réflexion profonde sur ce que parler de liberté veut dire.
Le roman commence le 1er septembre 1939, au moment où l’Allemagne attaque la Pologne et s’apprête à mettre l’Europe à feu et à sang. Maya et son frère Marwan écoutent avec stupeur l’annonce de ces événements à la radio au sein d’un Maroc colonisé. L’agression de la Pologne par l’Allemagne fait sinistrement écho à une autre forme de violence moins visible, dont sera victime Maya. Agée de quinze ans, celle-ci est contrainte d’arrêter l’école et de se marier avec Hicham, l’homme que sa famille a choisi pour elle. Le premier contact avec son mari sera violent dans tous les sens du terme. Lorsqu’ils se retrouvent pour la première fois en tête-à-tête, Hicham commence par gifler violemment Maya pour lui montrer qui est le maître. Ensuite, il la viole sans se soucier de la souffrance que son corps masculin lui fait subir : « Hicham s’est enfoncé si violemment en moi que j’en ai hurlé de terreur et de souffrance mêlées. Ce fut extrêmement douloureux, comme si des ciseaux vous étaient enfoncées dans le corps, dans vos parties les plus intimes » (pp. 21-22).
Mais la violence est aussi « symbolique » pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu. Elle ne s’exerce pas uniquement sur le corps de la personne dominée mais aussi sur son esprit. Maya vit son mariage comme un enfer. Elle sombre dans la mélancolie, la tristesse, la peur que son mari rentre de mauvaise humeur et la batte pour un oui ou pour un non. La violence symbolique qui s’exerce sur elle, c’est cette incapacité de parler à son frère des brutalités exercées par son mari, en se disant qu’il ne pourra pas changer grand-chose à ce qu’elle vit. Le poids des structures patriarcales est omniprésent dans le roman. La seule échappatoire est de continuer à se sentir libre dans sa tête, de ne pas laisser Hicham s’emparer de son esprit et de se plonger dans les livres tant qu’elle le peut. Cette liberté est plus forte que tout et traverse même les époques puisqu’elle interpelle également notre monde contemporain, celui dans lequel évolue Lilya, journaliste, en relation libre avec son conjoint dans un Maroc décolonisé et composite.
L’analogie synchronique entre l’agression de la Pologne par l’Allemagne et l’agression du corps de Maya par Hicham se transforme en une affinité élective diachronique à travers la mise en perspective de Maya et Lilya. C’est là toute la subtilité de l’exercice de style entreprit par Loubna Serraj dans ce roman. Faire dialoguer directement et indirectement deux femmes très différentes, évoluant dans deux contextes distincts mais néanmoins mêlés par le temps dans lequel le présent devient perpétuellement passé et le futur perpétuellement présent.
La question qui se pose est de savoir s’il est possible de vivre libre dans un monde injuste, un monde où les femmes ne disposent pas des mêmes droits que les hommes, un monde où les hommes sont sujets et les femmes sont objets ? Le lendemain du mariage, lorsque Maya fait mine de vouloir se plaindre à sa mère du traitement que lui a fait subir son mari, celle-ci lui rappelle quelle doit être la « bonne » attitude à adopter : « Une bonne épouse est censée faire ce que son mari lui dit et dicte. Rappelle-toi cela […] Je n’ai pas envie d’entendre des jérémiades, Maya. C’est cela être une femme. Tes sœurs te diront la même chose » (p. 26). On ne nait pas femme, on le devient dira Simone de Beauvoir une dizaine d’années plus tard ; elle qui avait d’ailleurs été en vacances au Maroc avec Sartre l’été 1939.
Hicham fait sentir dès le départ à Maya qu’elle est sa propriété, qu’elle doit lui appartenir corps et âme. Elle ne peut renoncer à la perte de liberté de son corps mais s’attachera préserver la liberté de son esprit. C’est ce que découvre Lilya en se lançant sur les traces de sa grand-mère défunte, dont la voix d’outre-tombe raisonne encore aujourd’hui dans un monde où les violences conjugales perdurent. Elle rencontre Marwan, presque centenaire, qui lui parle de Maya et l’amène à se remettre en cause sur ses propres jugements : « Que sais-je du profil des femmes battues par leur conjoint ou époux pour me permettre d’être si sûre de leur faiblesse ou de leur soumission ? J’avoue que ce que m’a révélé Marwan sur la joie de vivre, l’élan et la curiosité de Maya ne collent pas avec l’image d’une femme soumise et battue » (p. 190).
Mais est-on aussi libre qu’on le croit ? Pas sûr. Même dans sa tête, Maya n’a pas pu disposer d’une liberté totale, notamment celle d’aimer ses enfants comme elle voulait ou de quitter son mari pour faire sa vie avec ce soldat français amoureux d’elle (l’ennemi n’est pas forcément où l’on croit et un monde constitué par l’opposition ami/ennemi est un monde invivable, comme l’indique notre monde contemporain en guerre). Même si, à l’instar de Simone de Beauvoir, Loubna Serraj montre que l’instinct maternel n’est pas naturel aux femmes, force est de constater que les viols conjugaux subis par Maya l’empêchent de ressentir l’affection qu’elle aurait pourtant souhaité avoir pour ses enfants. La liberté est certes là – et personne ne peut en effet parler à la place des victimes, surtout pour corriger un ressenti – mais elle n’est en aucun cas totale – et c’est sans doute là que se trouve aussi l’importance de la parole des témoins qui assistent au drame et qui n’auraient en effet jamais dû accepter silencieusement l’intolérable. La question reste ouverte. Est-on libre au sens de Sartre ? Selon ce philosophe, on est condamné à être libre, c’est-à-dire à faire des choix et à les assumer vis-à-vis de soi-même et des autres. Même lorsque la maladie ou bien un événement terrible s’abat sur nous, nous restons libre dit Sartre. Nous perdons certaines possibilités mais d’autres s’offrent à nous, d’autres possibilités parmi lesquelles nous devons choisir. Je n’ai pas choisi d’être dans la situation d’une femme battue mais je peux choisir quel type de femme battue je serai. De ce point de vue sartrien, Maya est une femme libre. Toutefois, Simone de Beauvoir avait opposé certaines critiques implicites à la conception sartrienne de la liberté, en affirmant à partir de l’image de la femme enfermée dans un harem domestique ou bien de tous les mythes que les sociétés européennes construisent autour d’elle, qu’il y a des situations où la femme est condamnée à ne pas être libre et qu’elle doit rompre, y compris par la force, à son asservissement. La lectrice ou le lecteur répondront mieux que nous à la question de savoir si Maya est une femme libre et quelle est la nature de sa liberté.
Le roman de Loubna Serraj montre de quelle façon l’héritage que nous recevons des générations passées est légué sans aucun testament et que c’est à nous, la multitude cosmopolitique, de réinventer la tradition, avec les valeurs humaines qui sont les nôtres.