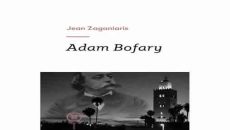Le pire des mondes possibles ?
Après « Le ciel sous nos pas », Leïla Bahsaïn revient avec un deuxième roman « La théorie des aubergines », également publié aux éditions Albin Michel. L’ouvrage évoque la vie d’un petit groupe de personnes qui tentent de se réinsérer professionnellement en suivant un stage de cuisine.
Dija travaillait en tant que cadre dans une agence de communication. Elle vient de perdre son emploi, après que sa boîte ait été rachetée par une grande entreprise. Le nouveau boss, surnommé Le poulpe, en référence à un personnage de James Bond, ne fait pas dans le détail. C’est un businessman, pas un philanthrope. Il est là pour faire du fric. Point. Du coup Dija se retrouve à pointer à Pôle Emploi et à subir les relations kafkaïennes avec une conseillère croulant sous le travail. Dija, c’est Khadija Abdelhilalilakbir. Mais quand elle intègre l’agence, tout le monde l’appelle Dija Ben parce que c’est la mode du court et aussi parce les connotations arabes passent mal dans un monde où les attitudes racistes tendent à se généraliser imperceptiblement.
Dija a donc été virée parce qu’elle n’a pas su saisir le virage du numérique, parce que la nouvelle direction veut réduire les effectifs, parce que l’on vit dans une période de précarité, d’indifférence à l’égard de la qualité du travail d’autrui. Aujourd’hui, dans nombre d’entreprises, les salariés ne sont rien d’autre que des post-its sur un mur, des numéros dans un ordinateur. Ce sont des objets, ce ne sont plus des sujets. Ce sont uniquement des moyens dont on se sert pour gagner de l’argent et plus des fins, notamment du point de vue du respect dû à leur personne, quelle qu’elle soit. Dans un ouvrage intitulé « Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville global », Mike Davis montre de quelle façon la rénovation urbaine accompagnée des grandes réformes néolibérales impulsées par le FMI et la Banque mondiale a développé l’étendu de la précarité, du travail informel et aliénant ainsi que les logements insalubres dans des sphères para-urbaines de plus en plus étendues. Le pire des mondes possibles, c’est un monde où les individus sont brisés intérieurement par un mode de vie où tout est incertain, aléatoire, arbitraire et instable, un monde où les chances de vivre dignement sa vie sont minimes et où il n’y a plus de fraternité entre les individus.
Ce pire des mondes possibles, c’est celui que vivent au quotidien les personnes que va rencontrer Dija lorsque son agence lui demande de revenir travailler pour eux en free lance afin de couvrir l’opération de réinsertion professionnelle entreprise dans ses locaux. Il s’agit d’offrir un stage de cuisine à une équipe de chômeurs de longue durée et de les entrainer à préparer des plats savoureux, notamment lorsque le préfet passera rencontrer ces personnes au sein de l’agence. C’est Achour, cuisinier professionnel confirmé, qui est missionné pour diriger cette brigade de néophytes. Il est supervisé par Jo, la comptable de l’agence, qui n’apprécie guère ces personnes appartenant aux classes dites « populaires ». Pourtant –et c’est là toute la force du roman – Leïla Bahsaïn sait rendre compte avec des mots l’humanité de ces demandeuses et demandeurs d’emploi tiraillés entre résignation et espérance, semblables à ces boxeurs sonnés par un coup et qui, allongés sur le ring, se demandent s’ils vont se relever et reprendre le combat ou bien attendre couché que l’arbitre compte jusqu’à dix.
Jean De est introverti, timide mais pourtant il rêve de trouver un emploi de paysagiste et de réussir un concours lui permettant d’exercer cette activité. Véronique a fait un burn-out qui lui a fait perdre son emploi mais elle veut repartir de nouveau. Ishtar, réfugiée syrienne, est pleine de vie et d’ambition malgré les traumatismes vécus. Toutes ces personnes ont leurs grandeurs et leurs bassesses mais ils n’en restent pas moins humains. Des humains pluriels, diversifiés, hybrides. A l’instar de « Le ciel sous nos pas », Leïla Bahsaïn explore les ambivalences identitaires de ses personnages. Dija est née au Maroc mais vit en France et est mariée à un Français. Contrairement à ceux qui pensent qu’il est impossible de concilier deux cultures différentes sans trahir l’une d’entre elles, le roman montre des formes de vie singulière renvoyant dos-à-dos le communautarisme et le reniement. D’une certaine façon, on est tous des mutants murmure quelque part Abdelkébir Khatibi. Le stage de réinsertion se transforme en un bol d’air pur, en une lueur d’espoir pour un avenir meilleur et apporte un peu de chaleur humaine, d’entraide, de solidarité entre ces personnes cabossées par un monde parfois inhumain. « Dieu que c’est beau » dirait Daniel Balavoine dont les chansons sont citées dans le roman. Au fur et à mesure que l’histoire avance, le groupe s’harmonise – au sens où l’entend l’artiste Christophe Chassol, également cité dans le roman.
Parmi les passages marquants de l’ouvrage, il y a des ces moments où l’auteure parle de la nourriture avant tout comme d’un souvenir : « Je détache mes cheveux et, à l’air libre, ma tignasse empeste le poireau brûlé. Je respire l’odeur, et j’ai soudain la nostalgie de ma mère » (p. 101). Il en est de même pour les poivrons ou le tajine de poulet-citron frites, restitués au lecteur avec toute la saveur que peuvent contenir les mots. C’est aussi notre mémoire qui nous rend humain, qui nous aide à remontrer une pente parfois rude et nous rappelle, grâce à certaines illuminations, que le pire des mondes possibles s’écrira toujours avec un point d’interrogation. Tant que la partie n’est pas terminée, de nouvelles étoiles peuvent apparaître et briller dans le ciel, éternellement.