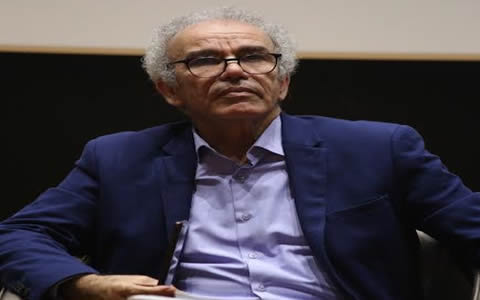Entretien avec l’écrivain et penseur, Ahmed Assid
Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef
Le film amazigh a connu son éclat dans les années 90 avec les films vidéo. Aujourd’hui, certes, beaucoup d’eaux ont passé sous les ponts, mais les stéréotypes et les clichés restent toujours les mêmes. Ce film, pour ne pas dire un cinéma, est confronté à de nombreux défis liés essentiellement à la qualité et la créativité. Les enjeux sont de taille. Or, l’avenir de ce film est entre les mains d’une nouvelle génération de réalisateurs et techniciens bien formés et encadrés qui essayent de donner une image différente et universelle à la culture et l’identité amazighes portées à l’écran. C’est dans le cadre de la 13ème édition du FINIFA qu’on a rencontré l’écrivain et penseur, Ahmed Assid qui nous a livrés cet entretien. Les propos.
Al Bayane : depuis les années 90, le film amazigh a fait son entrée dans la scène artistique surtout avec l’arrivée des films vidéo. Comment se porte aujourd’hui ce film pour ne pas dire un cinéma amazigh? Y a-t-il des avancements sur les plans cinématographique, technique et thématique ? Ce film est-il arrivé de sortir de son cadre amateur pour se professionnaliser et s’ouvrir sur d’autres publics au Maroc et même ailleurs ?
Ahmed Assid : certes, le film amazighe a commencé à travers la vidéo en 1993 par des amateurs comme Lahoucine Bouizgaren qui avait réalisé «Tamghart N’ourgh» et Mohamed Mernich ou encore Agourram et d’autres qui ont réalisé «Butfunast». C’étaient des films vidéo adressés au large c’est-à-dire les femmes au foyer, les commerçants, les couches populaires. Et puisqu’ils s’adressaient à un public qui n’avait pas de formation en matière du cinéma, donc il suffisait de filmer «La halqa». A l’époque, Il n’y avait pas réellement les structures d’un film ou d’un cinéma. C’était un travail d’amateur avec des moyens du bord. C’est pour cette raison, qu’on n’osait pas parler de cinéma pendant les années 90. Alors, on disait uniquement le film amazigh. Par ailleurs, avec la création de l’IRCAM en 2001, on était conscient du rôle important de la formation. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’on a décidé d’organiser des sessions de formations dans les domaines du théâtre, de la presse, du journalisme et de l’écriture du scénario et des résidences artistiques pour promouvoir la peinture.
Il y a certaines expériences individuelles qui ont fait quand même de bons films. Selon vous, la formation y est pour quelque chose ?
Pour le film amazighe, on était conscient de la nécessité de former une nouvelle génération de cinéastes amazighes dans tous les domaines : la réalisation, le scénario, la lumière, le son… pour arriver finalement à un bon film comme «Adios Carmen» de Mohamed Amin Benamraoui qui était en fait le commencement du cinéma amazighe parce qu’il y avait un vrai réalisateur, un vrai directeur d’acteurs et un vrai scénario. On peut dire que ce film là était le début. Après, il y a eu d’autres expériences qui ont avancé dans ce sens. On peut dire qu’aujourd’hui qu’on a une nouvelle génération de réalisateurs et de cinéastes et de scénaristes qui auront un grand avenir dans ce domaine.
Et le public dans tout cela ?
Le problème reste celui du public parce que la majorité écrasante du public amazighe, ce sont des gens illettrés issus des couches sociales qui ne sont pas instruites. Et c’est devenu un problème de communication c’est-à-dire qu’au au fur et à mesure qu’on avance sur le plan technique, mais on s’éloigne du public qui était visé auparavant par le film vidéo.
Il y a beaucoup de stéréotypes et de clichés dans le bon nombre de films, avec bien entendu quelques exceptions. Pensez-vous qu’il est temps que cette nouvelle génération devrait porter à l’écran cette culture et identité, mais avec une nouvelle vision et traitement cinématographique afin de s’inscrire dans l’universalisme ?
Certainement, d’une façon universelle, avec d’autres critères et une vision artistique un peu développée. Mais, autrement dit, ça va poser un problème de communication avec le public qui a l’habitude de regarder les films vidéo. Donc, il ne faut pas former uniquement les techniciens, les réalisateurs et ceux qui font des films, mais il faut également encadrer le public afin qu’il comprenne ce nouveau cinéma parce que le problème des valeurs dans le film amazighe est un problème sérieux. A vrai dire, il faut combattre les stéréotypes.
Que pensez-vous de certains professionnels de cinéma qui réclament à chaque fois le manque de moyens financiers et surtout le soutien au film amazigh ? Par exemple, cette année il y a une absence presque totale du film amazigh au festival national du film de Tanger. Où réside le problème exactement ?
Mon point de vue est le suivant : on ne peut pas cautionner la médiocrité. On peut encourager le film amazigh à travers la formation et l’encadrement et non pas en donnant de l’argent à des gens qui ne vont pas produire forcement de bons films. Il faut miser sur la formation et l’encadrement et après viendra le financement. Le problème ne se limite pas uniquement au soutien, mais le problème est plus profond. A mon sens, tout réside dans cette question d’encadrement et de formation.
Comme vous le savez le film un peu comme le livre amazighe, ils ont du mal à circuler. Selon vous, pourquoi les distributeurs et programmateurs des salles de cinéma tournent du dos au film amazighe ?
En fait, c’est la mentalité ancienne qui persiste et continue. Il y avait des changements, mais il faut encadrer la société et changer les mentalités. Au Maroc, on arrive à changer des lois et les textes facilement sans changer les mentalités. Et là, c’est la confrontation parce que pour avancer, il faut que les mentalités soient au niveau des textes et de la jurisprudence. C’est pour cette raison, il y a cette résistance. Par exemple, chez les libraires vous trouvez tous les manuels scolaires des matières sauf le livre amazighe qui a été édité par le ministère de la tutelle et une maison d’édition parce que les enseignants font des photocopies pour travailler en classe. Donc, il n’y a pas de livres parce qu’il y a cette mentalité discriminatoire qui continue.