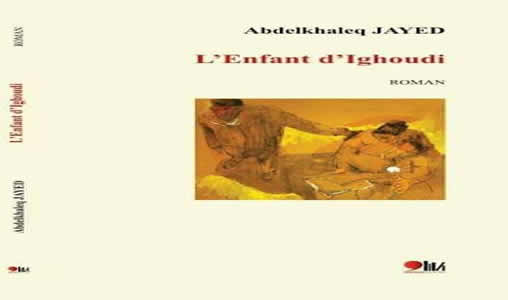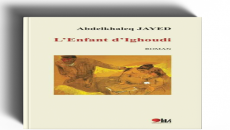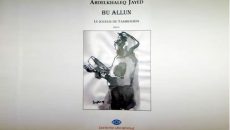L’enfant d’Ighoudi, Abdelkhaleq Jayed
Au Maroc, dans les milieux aisés des grandes cités, beaucoup sont celles et ceux qui ont eu la chance d’avoir tout hérité. Tout ce qui fait dans la vie, à la fois, l’essentiel et le luxe. En plus des biens matériels, cette élite, crème de la société, a bénéficié d’un précieux legs intellectuel.
Elle a aussi eu l’opportunité d’avoir mené une vie scolaire brillante dans des écoles réservées aux enfants des notables et aux familles issues des missions étrangères.
Ces enfants ont, donc, eu l’avantage d’ouvrir les yeux dans un cadre vital marqué par une culture hautement raffinée. Ils ont été éduqués dans un univers fait de fines civilités et de bonnes manières. De ce fait, leur imaginaire enfantin se trouve imprégné par cet accès aux beaux arts et aux belles lettres.
Dans ces milieux, hautes sphères sociales, l’enfance est une tranche d’âge idyllique. L’éducation et la socialisation y passent par des filtres d’amour, de tendresse, de sentiments idéalisés et de mots câlins. Ces jeunes pousses fraiches mènent, dans l’ensemble, une existence douillette. Bénis par Fortune, déesse de la chance, ces enfants naissent avec une cuillère en argent et une langue en or, dans la bouche.
Invitée pour parler de son parcours littérairement doré, dans l’une des plus prestigieuses librairies de la capitale, vitrine de l’apparat et foyer de la mondanité, une illustre dame a tenu ostentatoirement ces propos :
« J’ai eu la chance singulière d’être née dans un milieu où, depuis ma période prénatale, les sons et la musicalité de la langue de Molière chatouillait mon écoute. Après ma naissance, j’ai ouvert les yeux dans un entourage où tout le monde pratiquait, quasi exclusivement et à merveille, cette belle langue. Je suis, ainsi, élevée et grandi par et dans ses mots, entre les berceuses de la nourrice et les contes merveilleux de grand-mère ».
Dans le domaine littéraire, certain(e)s écrivain(e)s ou celles et ceux qui se considèrent comme tel(le)s, rappellent cette enfance bénie. Les histoires qu’ils racontent, relèvent de la vie au pays des merveilles et leurs écrits restent, le plus souvent, figés dans la nostalgie de ces univers idylliques Ainsi, ils n’arrivent pas à concevoir le monde autrement qu’à travers leurs lunettes dorées, et voient tout en rose et blanc, couleurs de fraicheur et de pureté.
Habitués des banquets littéraires, pour lesquels la littérature est réduite à un pur défouloir, ils venaient nourrir leur fantasme et désaltérer leur narcissisme. Pour la grande majorité, parmi eux, la littérature se cristallise dans ces messes pseudo-intellectuelles, occasions rare où on aime s’afficher avec un livre à la main, livre dont on a lu que la première de couverture.
Face à ce genre de littérateurs, complètement déconnectés de la réalité ambiante, voix faussement romanesques, Omar Mounir, dans son essai Dans l’intimité de l’écriture, écrit ce qui suit :
« Les marocains, tout comme l’ensemble du tiers-monde parlent avec les mots fabriqués dans le nord et pour le nord. Il leur est interdit de breveter un vocabulaire propre à exprimer leurs malheurs et leurs aspirations. Ils empruntent un vocabulaire, des fois fait pour d’autres qu’eux, des fois conçu contre eux, destiné à les démolir chaque jour un peu (…) » (1).
O. Mounir, par ces propos, laisser entendre que l’écriture, au sens romanesque, doit être une source qui irrigue la littérature, surtout celle qui, avec un vocabulaire adéquat et approprié, arrive à exprimer les vrais malheurs et les bonnes aspirations des marocains. Ecriture capable de sonder les couches profondes de la mémoire tatouée, marquée de fer et de feu, des peines et des souffrances, douleurs silencieuses qu’une grande frange de la population ne cesse de subir.
Le roman L‘enfant d’Ighoudi, écrit par Abdelkhaleq Jayed, est un nouveau-né littéraire, pleinement digne de ce qualificatif. L’écriture s’y opère telle une sève nourricière qui revitalise la littérarité. La narration y puise dans un creuset de sédiments fait de malheurs que ne cessent d’endurer des femmes et des hommes. Celles et ceux que l’Histoire a mis de coté, habitants éternels des montagnes et des collines oubliées, au-delà des grandes murailles des grandes cités.
Le récit, dans l’enfant d’Ighoudi, loin d’être un souffle léger de mots, est un dur travail de labeur, l’écriture y consiste à tourner et retourner les strates du sol aride de ce gisement fait de cette masse opaque de vies humaines, socialement écrasée et décomposée.
Cette œuvre romanesque, écrite sous l’effet des réminiscences et nourrie de sentiments à l’état brut, puise profondément dans la mémoire d’une population qui ne vit vraiment pas, mais tente plutôt avec peine, de survivre pour ne pas se morfondre dans l’oubli, sous le poids du marasme du quotidien.
L’histoire se décline en micro-récits qui dérivent d’un macro-récit. Ce dernier se déclenche suite à la triste nouvelle de la maladie du père du protagoniste, avec tout ce que l’image du géniteur symbolise au sein d’une famille patriarcale. Cette nouvelle va agir comme un catalyseur qui intensifie la narration.
Dès le début, le lecteur va se trouver transporté par une narration houleuse. Le personnage principal Amnay, pour se rendre dans son village natal, entreprend un voyage entre Agadir et Ighoudi.
Récit de voyage dans l’espace, à travers petites villes et villages, traversée transitoire, dans de petites contrées, quasi non localisables sur la carte du pays : Asli, Zaouïa, Tafoungoult, Tighdouine… patelins surgissant des non-lieux où des âmes errantes vivent hors du temps.
Au fil des récits, des tableaux se dessinent et se profilent, exposant des scènes décrites à chaud. La sénilité ambiante côtoie la laideur cynique. Le tout finit par fusionner pour cerner l’homme et son environnement. Des microcosmes sociaux où des vies humaines végètent, telles des herbes, nuisiblement, sauvages. Un univers débordant d’une réalité faite de misère, de gueuserie et de voyoucratie. Descriptions en filigrane coupées par des échappées narratives, un va-et-vient, dans le temps et dans la mémoire. Des souvenirs refont surface pour déterrer les différentes couches d’un vécu individuel calqué sur un vécu collectif.
Amnay, tout au long du voyage revoit, via le prisme des réminiscences, des scènes de sa vie, débris d’un parcours social éclaté. Enfance à Ighoudi, adolescence à Tighdouine, jeunesse à Paris et l’âge adulte à Agadir.
Dans ce devenir socio-familial, l’enfance occupe une place importante dans la narration, étant donné que, pendant la prime enfance, les traits psychiques s’impriment et se fixent une fois pour toutes, d’où le titre du roman L’enfant d’Ighoudi. Une histoire, dédiée, bel et bien, à l’enfance.
Dans ce récit, Ighoudi désigne le nom du petit village natal d’Amnay, localité proche de la petite ville Tighdouine, située à quelque centaine de kms de la capitale Rabat. D’un coté, le vocable Ighoudi s’apparente, phonétiquement, avec Ighoud, nom qui renvoie à la découverte archéologique des ossements d’un homo-sapiens remontant à 300000 ans, baptisé l’homme d’Ighoud, puisqu’on l’a découvert à Jbel Ighoud ou Adrad n Ighoud, en berbère D’autre coté, le terme Ighoudi s’apparente aussi avec le qualificatif Ighouda, en amazigh, qui signifie « beau, charmant et joli ».
Toutefois, l’enfance dans le roman n’est pas à extraire de la vie du clan et du destin familial. Elle se dissout au sein de cette dernière. Amnay, à défaut de résister, se laisse emporter par les flots houleux de son vécu familial.
Mennan ( le père), Mamoun ( le frère ainé ), Ammeur et Lahcen ( les deux autres frères ), Imma Kenza ( la mère ) et Mouna ( la sœur ) sont les noms des membres d’une même famille, nombreuse non tant par ses membres, que surtout par le poids des peines et des souffrances que traine chacun d’eux dans son histoire personnelle : Tranches de vie qui se déchirent, sous les coups des tracas et fracas qui s’abattent sur ces âmes et les violentent.
La conscience d’Amnay l’enfant fragile, telle une éponge, se trouve contrainte de les absorber et de les porter, telles des blessures, dans son âme.
Amnay, cette appellation signifie le cavalier, mais sous l’effet, déchirant et pesant, des souffrances qu’endurent les siens, devenues fardeau pour lui, ce nom finit par signifier celui qui porte et qui supporte. Toutes ces vies, difficilement vécues, marquent, tels des électrochocs, de profonds sillons la vie de l’enfant d’Ighoudi, cet être fragilement vivant.
Tout ceci étant, la grande chance d’Amnay s’avère être son éveil précoce à la lecture. Avide des mots et inconditionnel passionné de livres, il en fait son arche de Noé. Qu’il s’agisse des livres que lui achète son père ou de ceux que lui prête Jacques Leroy, le coopérant français, les livres constituent, pour lui, un refuge auquel il accède en quête de la lumière qu’il ne trouve pas dans le giron familial. Par ces lectures salvatrices, il fait en sorte que l’univers sombre de son entourage soit sublimé.
De ces longs moments de souffrances, face aux autres, son enfer, nait chez lui, le désir ardent qui le pousse à lire encore et encore, beaucoup de livres. Ainsi, des lectures infinies, tant désirées, vont surgir les jalons des premiers projets d’écriture. Projets qui vont alimenter en douceur sa vocation d’écrivain. Pour ce faire, Il puise sa matière première, d’une part, dans l’intimité familiale des vies qu’il sonde, d’autre part, dans celles des habitants d’Ighoudi, ces laissés- pour- compte, qui se morfondent dans l’oubli. Dans l’ensemble, ce sont des miséreux et des misérables qui se déchirent sous les coups de la scie rouillée des traditions passéistes, de l’hypocrisie sociale, de la profonde inculture, d’un vécu collectif des boucs et des espoirs sans lendemains.
Ighoudi est, pour cet enfant rêveur, un bourg où la jeunesse agonise à petit feu. Un taudis, à ciel ouvert, où des vies s’étouffent par excès de laideur et de désespoir. Dans ce trou noir, où les jours sont sombres et la réalité morose, Amnay ne se lasse pas de puiser sa lumière dans les livres.
L’enfant d’Ighoudi a grandi dans une culture complètement marquée par l’oralité. Ayant l’amazighe comme langue maternelle, il a vécu sous l’emprise de la poésie. Belles paroles et airs de chants que fredonnait sa mère, dans ses moments d’extase, de rêverie et de songe.
Pourtant, lui, il cherche une langue qui puisse le sauver, le libérer et l’aider à trouver sa propre voie vers l’expression littéraire.
Cette langue libératrice et sauveuse, il arrive à la forger, à la travailler et à la sculpter, à l’image d’une fée numide, suite à ses lectures dans des chefs d’œuvres écrits par de grands auteurs, Hugo, Proust, Flaubert, Balzac, Stendhal, Daudet, Camus, Chraïbi, Yacine, Al Mutanabbi, Gibran Khalil Gibran …entre autres.Dans sa tête, l’oralité berbère et la prose écrite française font bon ménage.
Deux imaginaires, deux langues se côtoient et s’accordent harmonieusement. D’où le fond intellectuel, substance littéraire, qui jalonne et nourrit son écriture. Substance que traduit concrètement à merveille la langue de Molière.
Concernant, justement, son attachement à cette langue, Abdelhak Serhane, auteur Des enfants des rues étroites, natif de Séfrou, petit village à l’image d’Ighoudi, ne manque pas, lors de ses rencontres littéraires, de reconnaitre à la langue française, au moins, deux faveurs.
La première, à savoir, ce qu’il ne cesse de répéter, remerciements à l’appui, que c’est grâce à cette langue qu’il a réussi à gagner dignement sa vie, en tant qu’enseignant. La seconde, que c’est en s’en servant, qu’il est devenu l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Amnay, aussi, s’estime très chanceux pour avoir, grâce à cette même langue, réalisé son double rêve, devenir, en même temps, universitaire et écrivain.
En guise de fin, le roman d’Abdelkhaleq Jayed L’enfant d’Ighoudi s’ouvre et se referme à Agadir. Référence littéraire, cette ville doit rappeler manifestement un autre enfant, terrible celui-là, au sens créatif du mot, Mohammed Khair Eddine, auteur du roman phare Agadir, né dans un autre petit village rocailleux, dans cette terre brulée du sud du Maroc.
Tous ces enfants, dans l’ensemble simples fils de paysans, d’éleveurs ou de nomades, sont, en dépit des milieux très modestes d’où ils émanent et des conditions de vie difficiles dans lesquelles ils ont vécu, devenus des écrivains en dévorant des livres et en buvant des mots, comme nourriture de l’esprit et du ventre, et ont ainsi rendu à la littérature marocaine ses lettres de noblesse.
De ce fait, leurs parcours, leurs vies et leurs œuvres devraient nous faire penser à ce dicton arabe : « lawla abna’ alfuqara’ lada3a al3ilm » ce qui veut dire : Sans les enfants des pauvres, la science (le savoir) serait perdue. Mais avec l’histoire de l’enfant d’Ighoudi, ce même dicton, paraphrasé, devient : « lawla attfal, mithl ttifl ighudi, lada3a al adab », ce qui veut dire, Sans enfants, tel l’enfant d’Ighoudi, la littérature serait perdue.
Note :
(1). Omar Mounir Dans l’intimité de l’écriture, Marsam Edition, 2007
Abdelkhaleq Jayed, L’enfant d’Ighoudi, Virgule Edition, 2020